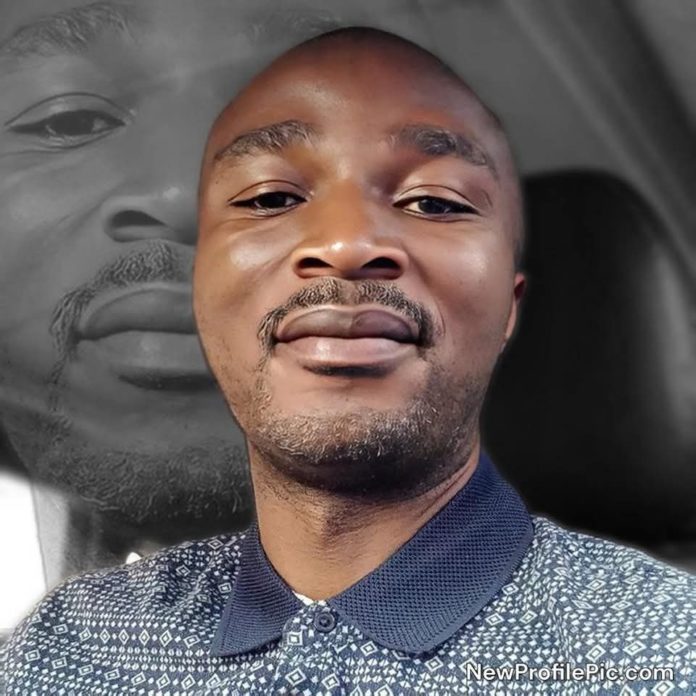Quarante ans après sa mort, le nom d’Ahmed Sékou Touré continue de diviser. Pour certains, il reste le symbole du populisme et de l’État-parti. Pour d’autres, comme moi, il demeure l’incarnation de la dignité guinéenne face au colonisateur. Entre ces lectures tranchées, l’histoire mérite d’être restituée dans toute sa complexité.
1958 : un choix fondateur
Le 28 septembre 1958, la Guinée dit NON au projet de Communauté proposé par De Gaulle. Ce refus, porté par Sékou Touré, fut bien plus qu’un choix national : il ouvrit la voie aux indépendances africaines. Sans ce « non » courageux, il est peu probable que des figures comme Senghor ou Houphouët-Boigny eussent obtenu aussi rapidement des concessions de Paris.
Mais ce choix souverain eut un prix. La France se retira brutalement, sabotant archives et infrastructures, isolant la Guinée sur le plan diplomatique et organisant, avec la complicité de certaines élites africaines, une véritable guerre froide contre Conakry.
Une résistance avec ses ombres et ses lumières
« L’indépendance est à la portée de la Guinée », avertissait De Gaulle, « mais des conséquences, la France en tirera ». La menace était claire : quiconque osait défier la métropole en paierait le prix.
Face à cet isolement, Sékou Touré fit le pari de l’unité nationale, de la mobilisation populaire et de la construction d’un État souverain. Était-il exempt d’erreurs ? Non. Comme tout père fondateur, il porta à la fois une part d’ombre et une part de lumière. Ses acquis restent pourtant indéniables :
- Une indépendance réelle, loin des indépendances sous tutelle ;
- Une diplomatie panafricaine active, qui inspira Lumumba, Cabral, Nkrumah ou Mandela ;
- Une identité nationale forte, où la dignité noire et la fierté guinéenne furent affirmées au monde ;
- Une monnaie nationale, quand tant d’États africains demeurent encore prisonniers du CFA, aujourd’hui largement contesté.
L’héritage matériel et moral
En mars 1984, au moment de son décès, les fondamentaux de l’économie guinéenne étaient au vert, malgré les tonnes de faux billets injectés par la France pour asphyxier le pays. Le bien public était sacré, le service à la nation une vertu. Les grandes infrastructures bâties sous son mandat, port autonome, aéroports, compagnie aérienne AIR GUINEE et ferroviaire, chemins de fer, routes, stades, universités de Conakry et de Kankan, Palais du Peuple, tiennent encore debout. Elles témoignent d’une vision d’État.
Son esprit, lui, reste vivace en Afrique. Au Sénégal, au Mali, au Burkina, au Niger… le rejet du franc CFA, la montée du souverainisme et le désaveu de l’armée française, autrefois pilier de la Françafrique, résonnent comme un écho à son combat. Après 40 ans, l’histoire lui donne raison. Palais, rues, aéroports portent fièrement son nom en Guinée et ailleurs.
Le vrai malheur de la Guinée
Le véritable malheur de la Guinée n’a pas été d’avoir Sékou Touré comme premier président. Le malheur est venu après.
En 1984, une erreur de casting place au pouvoir Lansana Conté, militaire patriote mais peu préparé aux enjeux géostratégiques et économiques du moment. Préférant le champ au bureau, il délègue les affaires à une première génération de cadres sans scrupules. Résultat : libéralisation sauvage, braderie des usines, enrichissement illicite d’une élite prédatrice. Ce basculement plonge la Guinée dans une spirale de népotisme, de gabegie financière et de décadence institutionnelle.
Depuis, les transitions militaires sans issue et l’incapacité chronique de l’élite à proposer une vision continuent de ruiner le pays. Pire encore, une partie de la jeunesse, plus avide de confort que d’effort, a renoncé à l’esprit de sacrifice qui avait fait la grandeur de 1958.
Pour une lecture dépassionnée
Réhabiliter Sékou Touré ne signifie pas nier ses excès. Cela signifie replacer son action dans un contexte implacable : celui d’un pays sous siège, où chaque pas vers la liberté était combattu par les puissances coloniales avec la complicité de voisins africains et de certains guinéens. Les résultats du OUI au référendum de 1958 par préfecture suffisent à révéler ces fractures.
L’urgence aujourd’hui n’est pas de réchauffer une haine par procuration pour quelques « likes » sur les réseaux sociaux. Elle est de tirer les leçons de son héritage – réussites comme erreurs – pour construire une Guinée plus forte, plus juste et plus unie.
CAMARA ABDOULAYE T.
JURISTE
SEKOUTOUREISTE